MARIE-MADELEINE
ET JÉSUS
__________
Vérités et idées
fausses sur Marie-Madeleine épouse du Christ,
sur la descendance de Jésus, Marie-Madeleine et RENNES-LE-CHÂTEAU,
MARIE-MADELEINE et le Da Vinci Code…

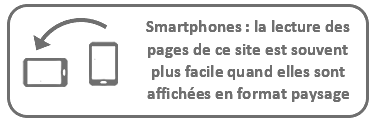
Il a
beaucoup été dit et écrit sur Marie-Madeleine, en particulier depuis les
ouvrages concernant Rennes-le-château et le « Da Vinci code » de Dan Brown.
L’idée principale est que le personnage de Marie-Madeleine aurait été en partie
occulté par l’Église pour dissimuler de nombreux secrets : son rôle aux
sources du Christianisme, sa vie de couple avec Jésus, voire même une
éventuelle descendance du Christ. Ces dernières décennies, des auteurs
l’imaginent non seulement disciple fervente comme la présentent les évangiles,
et la première personne à avoir vu Jésus ressuscité, mais aussi à l’origine
d’idées ésotériques, d’enseignements mystérieux, seulement transmis par des
évangiles apocryphes et des sociétés secrètes.
Qu’en est-il réellement ?
|
Jésus ne pouvait pas
être célibataire et des évangiles cachés présentaient Marie-Madeleine comme
sa femme, ce qui explique que l’Église aurait occulté
ce personnage ? Il est vrai que des textes méconnus, retrouvés au XXème
siècle en Égypte, tels que l’évangile de Philippe et l’évangile de Marie,
évoquent des jalousies entre les apôtres, et le rôle prééminent de Marie-Madeleine,
que Jésus, dixit, embrassait « sur la bouche ». Non seulement ces
évangiles sont particulièrement discutables pour établir une vérité
historique (les évangiles gnostiques sont plus tardifs que les autres,
souvent écrits en Égypte, emplis de doctrines étranges imprégnées
d’influences païennes, de croyances en une cosmologie très originale,
d’entités divines multiples et aux relations complexes…), mais l’on oublie de
dire notamment aussi que, dans ce passage précis… le mot « bouche »
est en fait absent du texte original, ce qui n’est pas le moindre des
détails ! C’est en réalité la traduction moderne qui le rajoute là où il
manque ! De surcroît, le même manuscrit déclare que Jésus embrassait
d’autres apôtres sur la bouche : dans cet étrange monde gnostique,
c’était un signe d’initiation. Enfin, il est à noter que plusieurs autres
textes de l’antiquité et évangiles apocryphes montrent que ce baiser était
couramment donné dans le cercle familial ou même seulement amical : on
comprend donc combien les longues interprétations basées sur ces quelques
mots, sans aucune connaissance des us et coutumes du moment, ont très vite
fait de s’égarer. De même, en abandonnant notre regard moderne et éloigné des
textes et en se replaçant dans le contexte gnostique de l’époque, les
spécialistes considèrent comme synonymes des mots tels que
« époux », « seigneur » et
« maître (spirituel) ». Les partisans de la thèse « Marie-Madeleine
épouse et initiée » jouent allègrement sur ces différents sens, quand
ils ne s’appuient pas tout bonnement sur des faux réalisés sur des papyrus
minuscules où l’on aurait l’incroyable chance d’y trouver, par un hasard
extraordinaire et au milieu de phrases curieusement recopiées d’autres
textes, juste les quelques mots polémiques qu’ils attendaient. Mais même si
l’un de ces manuscrits était un jour incontestablement authentique, le
contexte gnostique ou mystique demanderait d’y comprendre « époux »
comme « maître », et « épouse » comme
« disciple » comme cela est attesté depuis longtemps et de façon
certaine : dans l’Ancien Testament déjà en effet, notamment dans le
cantique des cantiques et dans plusieurs écrits apocalyptiques, « l’épouse » est clairement le
symbole de la communauté de ceux qui sont fidèles à Dieu, tous ses
membres étant les époux et les épouses de… Dieu ; de nos jours encore,
l’Église est appelée « épouse du Christ » ; les papes et les
évêques portent au doigt un anneau qui symbolise leur union avec Dieu ;
les religieuses évoquent leur vocation comme un mariage avec Jésus etc. Au-delà de ce sens symbolique établi, Jésus était-il tout de
même en couple ? On lit ou l’on entend souvent en effet que tous les
rabbins de son époque étaient mariés, qu’il était mal vu de pas l’être dans
le monde juif... C’est vrai à un détail près : cette règle semble plus
tardive et, quoiqu’il en soit, à l’époque de Jésus beaucoup étaient tout de même célibataires comme les moines et les
prêtres de nos jours, notamment parmi les esséniens, qui se trouve être le
groupe qui présente le plus de ressemblances avec les chrétiens (communauté,
prière, interprétation des, prophéties, croyances messianiques, repas en
commun, rite de purification par l’eau, réputation de guérisseurs…). Il en
était certainement de même des nazôréens, dont faisait partie Jésus (inspiré
du terme de « nazir », sorte de moine itinéraire réputé pour sa
pureté). Il en était certainement de même de Jean-Baptiste, un des grands
noms de la secte et que personne n’a jamais prétendu être marié ; comme Jésus
on le comparait aux prophètes Élie et à Élisée qui étaient réputés être…
célibataires eux aussi. Il en était de même de saint Paul et d’autres grands
noms du Christianisme, qui prônaient le célibat. Le texte de l’apocalypse,
très imprégné des écrits de l’Ancien Testament et de l’époque
intertestamentaire, donc bien avant une éventuelle influence de l’Église,
parle également de saints près de Dieu qui, dixit, « ne se souillèrent
pas avec les femmes »… on voit
donc que, contrairement aux idées avancées par certains, le célibat est loin
d’être inédit dans le monde juif, et il l’est encore moins dans les cercles
qui se trouvent être – est-ce un hasard – les plus proches du
mouvement de Jésus, tous ceux-là qui recherchaient une forme de pureté et
de sainteté : rien à voir visiblement avec la prééminence, trois ou
quatre siècles plus tard au moins, de l’Église de Rome. Entre temps
l’on a pu voir, dans le Christianisme oriental lui aussi, la venue d’ermites
et de moines, célibataires eux encore… on peut d’ailleurs constater ici l’une
des nombreuses ressemblances avec ce qui est pratiqué dans le
bouddhisme : voir notamment « l’évangile
selon l’olivier », librement téléchargeable en cliquant sur ce lien, et
qui recense les nombreux parallèles entre ces grandes religions. Quant au rôle de Marie-Madeleine, il est bien difficile de
soutenir qu’il a été occulté, et de faire reposer sur cette idée un
échafaudage de secrets pouvant mettre en péril la chrétienté entière… en
effet, malgré la culture patriarcale de sa région d’origine et qui
transparaît encore dans les us et coutumes du catholicisme et de
l’orthodoxie, on ne peut le nier, le Christianisme a tout de même la
particularité de mettre en avant les femmes davantage que toute autre grande
religion. Des femmes faisaient même
partie des disciples de Jésus, fait exceptionnel pour l’époque. Marie est
extrêmement vénérée et en particulier dans le monde catholique et orthodoxe,
et il en est de même de Marie-Madeleine, loin d’être occultée comme
l’affirment quelques auteurs : certes elle est présentée dans un texte
(un seul) comme une pécheresse repentie et sa présence est assez discrète
dans plusieurs évangiles, mais il en est de même de bien d’autres
personnages, et l’ouvrage « l’évangile selon les prophètes et les
mystiques », librement téléchargeable en cliquant sur ce lien, en apprend
davantage sur l’identité de quelques personnages des évangiles, et sur la
nécessité de la clandestinité. Marie-Madeleine, issue de la haute société de Jérusalem,
n’échappe pas à cette règle qui concerne d’autres aussi. Cela exclut au
passage les thèses de ceux qui la présentent comme une sorte de prêtresse
païenne. Loin d’être occultée de façon particulière, elle est aussi et
surtout présentée comme un disciple qui a cru en Jésus jusqu’au bout, avec en
récompense l’honneur de devenir le premier témoin de la résurrection. C’est assurément
pour cela que, partout en France et dans le monde chrétien, d’innombrables
œuvres d’art religieux la représentent, et d’innombrables églises lui sont
dédiées. En observant cela il apparaît donc bien difficile de suivre les
auteurs, avec leurs thèses sensationnalistes, qui affirment qu’elle
a été cachée.
|
|
Jésus et Marie-Madeleine
formant un couple, tel Isis et Osiris, et animés par
des croyances égyptiennes ? C’est la thèse en vogue chez plusieurs auteurs, en particulier
Lynn Pickent et Clive Prince dans « la révélation des Templiers ». Thèse
fort séduisante car il est vrai que l’on peut remarquer de nombreux liens
entre le Christianisme et les anciennes religions. Notamment on peut voir
d’évidentes ressemblances entre Marie tenant dans ses bras l’enfant Jésus et Isis
tenant contre elle son fils Horus :
De ce fait, bien des auteurs ont cru y déceler un lien entre
le Christianisme et le mythe d’Osiris. Cependant cette thèse se heurte à de
nombreux faits : -
Sur le fond, en y
regardant le plus près, on peut constater que la mort et la résurrection d’Osiris
a finalement bien peu à voir avec celle du Christ : Osiris n’a pas été
crucifié, il a été démembré ce qui n’est pas le cas de Jésus, il a été jeté
dans le Nil et pas Jésus, il a été tué par un autre Dieu et non par les
autorités du temple ni par les envahisseurs romains… il ne faut donc pas
longtemps non plus pour se rendre compte, en lisant la légende d’Osiris,
combien le style, l’esprit, sont différents des évangiles. L’idée même de
l’incarnation enfin, dans le Christianisme, a un sens et une portée bien
différents : il est une promesse pour tous et non pas seulement pour le
pharaon, car Jésus est Dieu et homme à la fois, et même homme seulement pour
certains courants proches du Christianisme, notamment l’islam : voir
notamment dans « l’évangile
selon l’olivier » , téléchargeable librement en cliquant sur ce lien, qui détaille les points communs
entre les grandes religions. Et pourtant l’on y trouve toute
une religion, encore plus clairement monothéiste et opposée à tout ancien
culte, et donc a fortiori où les rites isiaques sont totalement absents. -
La ressemblance
esthétique entre les représentations d’Isis/Osiris et de Marie/Jésus tombe
assez vite à l’eau également : si l’on croit en la correspondance, c’est
Marie-Madeleine qui devrait tenir le rôle d’Isis et non pas Marie… mais alors
ce n’est pas l’enfant Jésus qu’elle devrait tenir dans ses bras car dans les
représentations égyptiennes Isis tient son enfant, Horus, et non pas son mari Osiris. Or c’est lui qui est censé avoir ressuscité
et donc correspondre avec Jésus selon cette idée. Bref on voit que la correspondance Marie-Madeleine/Isis
est loin d’être parfaite. Elle date de l’avancée du christianisme dans le monde romain et en Egypte,
mais elle est superficielle et les similarités sont les mêmes que, de tout temps et
en tout pays, les ressemblances entre toutes les mères et leur enfant, représentations de surcroît assez
tardives dans le Christianisme. Rien d’autre
ne coïncide. De surcroît l’on trouve ailleurs d’autres représentations
d’autres déesses portant un enfant et qui ne sont pas Isis. On peut penser à Tanit notamment, qui fait penser à d’autres liens encore plus troublants qu’avec Isis, et que nous avons relevés,
comme l’image ci-dessous, dans « l’évangile selon le monde », librement
téléchargeable en cliquant sur ce lien.
Autant d’influences culturelles et esthétiques, qui ne se
rapprochent pas forcément du culte d’Isis. De fait, à part un ou deux points
communs (la représentation d’une mère et de son enfant et l’idée de la
résurrection), tout semble très différent. En réalité on ne peut même pas les relier par la croyance en la
résurrection : en effet celle-ci était présente également dans le monde
juif depuis des siècles : dans la Bible, Élie a ressuscité un enfant, Ézéchiel
a décrit la résurrection de la fin des temps, et d’autres encore…), d’autres
éléments sont inspirés du zoroastrisme ou ont totalement émergé du judaïsme,
et en tout cas sans qu’on ait besoin de faire appel aux croyances
égyptiennes. Difficile donc de prétendre faire reposer, comme certains,
toute la religion chrétienne sur les croyances égyptiennes. D’autres notions
semblent bien davantage, et bien plus fondamentalement, reliées aux croyances
juives, notamment la réalisation de très nombreuses prophéties, comme on le
constate dans l’ouvrage déjà cité précédemment, librement
téléchargeable ci-dessous. -
Ce n’est pas
tout : notons aussi qu’il existe des textes de l’antiquité, écrits dans
le même monde dans lequel est né le Christianisme, et même exactement à la
même période que les évangiles (Ier et IIème siècle de
notre ère). Et certains sont indubitablement empreints des croyances dans les
mythes isiaques. Ainsi notamment « l’âne d’or », œuvre très célèbre
du romain Apulée (écrit en Afrique du nord au milieu du IIème
siècle). Même époque, même culture que les évangiles donc mais… rien à voir. Le
texte raconte en effet l’histoire d’un héros transformé en animal, qui vit
des aventures multiples, devient l’amant d’une dame sous sa forme animale,
assiste à une apparition d’Isis tandis qu’il prie la Lune, redevient homme
lors d’une fête religieuse en l’honneur de la déesse et où l’on change 12 fois d’habits... Pas un seul élément
qui puisse se rapprocher des évangiles : dans ces derniers l’on ne trouve
aucune fête semblable aux rites isiaques, aucune référence à la Lune, aucune
de ces aventures spectaculaires. Inversement le texte d’Apulée, pourtant
philosophe sérieux, n’a rien à voir avec le style ni le contenu des évangiles
on l’a dit, mais pas davantage avec les épîtres de saint Paul, de saint Jean,
de saint Pierre… -
L’autre idée, défendue dans de nombreux ouvrages,
est que Marie-Madeleine oignant les pieds de Jésus serait le signe de l’appartenance à d’autres cultes,
et si ce n’est celui d’Isis, qui correspond assez mal comme on vient de le voir, ce serait alors celui de prêtresses païennes
s’offrant à leur roi... On comprend vite qu’il serait particulièrement absurde qu'on trouve
un tel personnage parmi une communauté de premiers chrétiens qui sont tous à l’origine des Juifs,
qu’on présente souvent de surcroît comme proche des esséniens,
c’est-à-dire très fervents, respectant toutes les fêtes juives notamment, et peu enclins à être influencés par l’étranger,
ce que montrent par exemple leur hostilité aux Romains et leur hésitation
à se tourner vers les Païens, saint Paul réussissant à les en convaincre au bout de plusieurs années et uniquement au prix de longs efforts.
Le récit d’un évangile présente bien une onction symbolique de Jésus, mais celle-ci a été particulièrement mal comprises par ceux qui y voient
un signe du christianisme adoptant des croyances étrangères du Moyen-Orient, alors que c’est en fait presque l’inverse, à savoir une volonté
de montrer un rayonnement du christianisme, né en Palestine, sur les autres civilisations.
En effet tout cela a pu être écrit avec exactement la même intention littéraire et religieuse que l’évangile montrant des mages
venus d’autres pays pour reconnaître en Jésus le nouveau roi du monde : un évangéliste (Luc) présente en effet cette notion au moyen des rois mages mais pas au moyen de l’onction des pieds de Jésus, et les trois autres à travers cette onction mais inversement n'évoquent pas les mages (Marc, Matthieu et Jean).
Ce n’est sans doute pas un hasard et cela signifie bien que ces événements sont équivalents pour les quatre évangélistes : ils signifient que
tous les cultes et les rites anciens s’effacent devant l’onction de Jésus, tous les peuples reconnaissent en Jésus le Messie, tout le monde reconnaît en Jésus son roi quelle que soit sa condition, hommes, femmes, de Judée ou de partout ailleurs, respectant déjà la loi parfaitement, moyennement ou pas du tout. C’est encore plus probable quand on lit dans l’évangile selon Marc, juste après cette onction de Jésus par Marie-Madeleine : « partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait ».
Et en effet, dès lors, loin de la passer sous silence comme on le lit parfois, d'innombrables églises seront dédiées à Marie-Madeleine dans la chrétienté.
-
Malgré tout ce que
l’on a déjà vu, il subsiste cependant l’idée selon laquelle Marie-Madeleine
aurait détenu un savoir secret, un Christianisme différent qui n’apparaîtrait
« ni dans les évangiles
canoniques, ni dans les textes des pères de l’Église, bref dans aucun texte
reconnu comme authentiquement chrétien ce qui est quelque peu curieux… je
propose donc ici autre chose : sachant
que Marie-Madeleine n’était pas une prêtresse obscure dispensant un savoir
particulièrement sulfureux et étranger au judaïsme comme on la présente
parfois, car elle était une personnalité de la société de Jérusalem comme
Nicodème et d’autres, Marie-Madeleine n’aurait donc pas dispensé un
enseignement secret, mais aurait probablement proposé que… l’enseignement de Jésus,
tout son enseignement, soit secret. Ou en tout cas dispensé d’une façon très
discrète en Judée. Et en effet, d’après les textes canoniques comme les
textes apocryphes, régnait après la mort de Jésus et la répression à
l’encontre des fidèles, un grand désarroi, un moment de flottement mais aussi
de crainte bien légitime, pendant lequel il n’y avait pas d’autre choix que
de rester caché. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’ensemble des écrits
chrétiens sont dès lors très discrets sur les principaux apôtres, présentés
sans presque aucune précision sur leur famille, leur parcours avant ou après
les récits évangéliques, bref sur leur identité… au point par exemple que peu
de textes chrétiens n’ont révélé que saint Jean a accédé à la charge de
grand-prêtre, ce qui était pourtant fort important et fort visible, ainsi
qu’on l’a vu plus haut [dans «l’évangile selon les prophètes et les mystiques »
librement téléchargeable en cliquant ici ou ci-dessous]. La consigne a
visiblement été générale : agir en Judée, mais d’une façon
clandestine ; agir en Judée, mais sans révéler son appartenance au
mouvement de Jésus ; c’est ce qui ressort encore lors de la rédaction
des évangiles (grande discrétion sur l’identité des apôtres on l’a dit, mais
aussi tous les éléments de la clandestinité lorsqu’il s’agit de trouver une
maison où célébrer la cène dans l’évangile selon saint Jean, entre autres
exemples). En revanche le mouvement pourra s’étendre d’une façon plus visible
et plus affirmée en dehors de la Palestine, dans tout le monde romain (et en
effet c’est clairement en tout cas la direction qui a été prise par les
apôtres). Cette clandestinité des débuts permet d’expliquer bien des choses
dans les évangiles. Elle a été aussi la source de fantasmes et de contresens
par ceux qui ont compris « clandestinité et discrétion » comme
« enseignement secret », sans doute car ils étaient influencés
par les cultes à mystères et d’autres croyances étrangères : les gnostiques. Mais
le véritable Christianisme s’est bien formé en Galilée et en Judée, auprès
des disciples et aussi des personnages importants que l’on a cités, comme on
peut le lire, entre les lignes, dans les évangiles. » (extrait de «l’évangile selon les prophètes et les mystiques »
librement téléchargeable en cliquant ici) On l’a vu, l’idée de rapprocher le Christianisme du culte d’Isis
était séduisante, et séduit encore les amateurs de croyances égyptiennes et
des cultes à mystères ; il en est de même de la tentation d’en faire la source d’un
enseignement secret, mais ce que l’on peut comprendre bien autrement et
cadrant bien mieux avec les réalités historiques de l’époque et qui ne sont
pas moins spectaculaires. Celles-ci permettent en effet d’en savoir plus sur les
personnages de saint Jean, de saint Paul, et de Jésus lui-même (son nom dans
le talmud, le nom de sa famille…) et de déboucher sur les croyances des plus
grands noms du Christianisme (qui n’ont rien à envier aux gnostiques en
hauteur de spiritualité): pour aller plus loin sur ce sujet, voir notamment
l’ouvrage déjà cité et librement téléchargeable ci-dessous. Si les cultes d’Isis semblent assez éloignés du Christianisme
quand on y regarde de plus près, il est cependant vrai que l’on peut voir de
nombreux liens entre le Christianisme et les anciennes religions, peut-être
même volontairement mis en évidence pour rapprocher des doctrines, totalement
juives à l’origine, de celles des pays que les apôtres commençaient à
convertir. Aussi, le Christianisme semble à la fois indiscutablement ancré
dans le judaïsme (péché originel, histoire, messianisme, prophéties
accomplies…) et rappeler certains aspects des religions plus primitives (rôle
de l’eau, symbolique de la pierre, et autres éléments astronomiques ou
symboliques), bref beaucoup de choses qui le relient aux mythes anciens, les héros de l’antiquité inscrits
dans les étoiles et dans les constellations et qui préfiguraient la venue du
Christ, et aux civilisations qui annonçaient cet avènement ainsi qu’on le constate
notamment dans l’ouvrage librement téléchargeable ci-dessous. |
|
Marie-Madeleine
reposant en France ? Un secret concernant Marie-Madeleine à Rennes-le-château ? L’idée de la venue de Marie-Madeleine en France repose sur
l’existence, en Provence comme ailleurs, d’anciens temples et lieux de cultes
de déesses païennes. Comme partout en Europe, des édifices chrétiens les ont
remplacés, et souvent dédiés à Marie et à Marie-Madeleine. Le lien avec la Provence
s’explique fort bien ainsi : on y trouvait en effet des lieux de culte à
Isis, à vénus… ajouté au fait que le mot « grotte » en provençal a
donné le mot « baume » (massif de la sainte baume), d’où
l’association avec le baume dont Marie-Madeleine s’est servie pour oindre les
pieds de Jésus, et donc l’association avec Marie-Madeleine elle-même plutôt
qu’avec tout autre personnage des évangiles. On comprend donc très bien le lien qui a pu être fait entre
ces lieux, les personnages d’Isis, Vénus etc, et Marie-Madeleine… mais c’est
un bien étrange contresens que de se dire, comme certains auteurs qui
concluent, après des pages entières de recherche, ce qu’ils voulaient prouver
dès le début à savoir en substance : « si l’on vénère Marie-Madeleine
là où il y avait un culte à vénus, alors c’est que les croyances de Marie-Madeleine
étaient celles de prêtresses de vénus ». Or si les lieux de culte
correspondent ce n’est pas parce qu’elle était inspirée par ces déesses, par
ces idées, par ces croyances : c’est précisément au contraire pour
supplanter, pour remplacer, et pour faire oublier ces cultes, que son image a
été employée. Il en est de même dans le Languedoc et dans les environs de
Rennes-le-château et de Rennes-les-bains. Comme son nom l’indique, cette
dernière est établie près de sources connues dès l’antiquité, avec leurs
anciens cultes à des déesses des eaux et qui ont été supplantés par des lieux
dédiés à Marie ou à Marie-Madeleine. Un trésor peut-il tout de même reposer dans les environs de
Rennes-le-château ? Peut-être, mais qui peut être très divers :
trésor du Temple de Jérusalem, trésor des wisigoths, trésor cathare, trésor
des Templiers, trésor royal, autre secret, ou complet canular… les références
à Marie-Madeleine sont certes assez claires dans l’église restaurée par
Saunière, mais elles sont nombreuses
dans de nombreuses églises de nombreuses régions de France et d’Europe, comme
par exemple à Vézelay, où une abbaye entière lui est consacrée, autant de
lieux où l’on ne cherche pas de mystère. Le trésor de Rennes était peut-être
plus ancien, et pillé depuis longtemps. Saunière n’en aurait trouvé que les
restes, et vivait sur ceux-là… et sur un trafic de messes, pour lequel il a
été condamné. Toute la légende de Rennes-le-château repose peut-être sur
cela, et sur le talent de quelques auteurs, le goût des énigmes et le
contexte de l’époque : voir ci-dessous. |
|
Des enseignements
mystérieux transmis par des sociétés secrètes et par
les Templiers ? Les mystères de Rennes-le-château, mis en avant par le « Da
Vinci code », ont beaucoup à voir avec les jeux d’esprit (références
historiques, énigmes, codes secrets créés par les personnages de Chérisey et Plantard…)
et avec les croyances royalistes (l’abbé Saunière au XIXème
siècle, comme Plantard au XXème siècle, étaient des royalistes
convaincus, très désireux de créer ou d’entretenir une légende autour d’une
descendance de Jésus incarnée dans la monarchie française à deux moments
importants pour elle : la IIIème république, puis la fin de
la seconde guerre mondiale, deux périodes où l’on a pu voir les derniers
soubresauts des espoirs monarchistes)… à cela s’ajoutent le goût des légendes
et des récits (de Gérard de Sède à Dan Brown l’histoire a intéressé de
talentueux auteurs, et de nombreux rêveurs et chercheurs de trésors), et la
recherche d’une assise plus solide encore de la part des sociétés secrètes
(quoi de plus noble en effet que de se rattacher aux égyptiens, aux
cathares…). Il était donc tentant, pour eux tous, de relier le personnage de Marie-Madeleine
aux autres croyances, symboles, et prédécesseurs glorieux qui seraient les
leurs, parmi lesquels les cultes égyptiens dont on a déjà parlé, et la grande
histoire des Templiers. En y réfléchissant bien, la thèse développée dans des livres
tels que « la révélation des Templiers » ou des romans tels que
« Da Vinvi code », selon lesquels des croyances autour de
« l’éternel féminin » auraient été « occultées par l’Église et
transmises par les Cathares et par les Templiers », semble assez
étonnante : les auteurs eux-mêmes peuvent dire dans une même phrase
qu’il est caché aux yeux de tous et en même temps qu’il est visible dans
toutes les cathédrales (forme des portes, noms « Notre-Dame » et
autres symboles…), et à travers les nombreuses saintes déjà honorées (Marie, Marie-Madeleine
mais aussi toutes les femmes qui ont été élevées au rang de « docteur de
l’Église » ce qui n’est pas le cas dans toutes les religions, loin de
là)… Rien d’occulté, donc. De surcroît relier cela aux Cathares et aux
Templiers apparaît plus que décalé : les Cathares, d’où leur nom, se
disaient « purs », rechignaient au mariage, et refusaient la chair
et tout ce qui pouvait rappeler le monde de la matière. Quant aux Templiers,
ils constituaient un ordre monastique et militaire on ne peut plus
masculin : alors que d’autres ordres étaient destinés aux femmes, eux
n’en admettaient aucune et formaient un groupe d’hommes si unis que cela a
paru suspect lors de leur procès, très fervents, et consacrés à la prière, à
la protection des biens ou des personnes et au combat. Une autre page sur ce site éclaire leur légende et
montre que les Templiers étaient d’authentiques moines qui avaient peut-être
découvert et ramené en Europe des objets, importants et mystérieux en effet,
mais qui semblent être plutôt des reliques, et en particulier le suaire de Turin. Pour ce qui est des symboles et des croyances, il est à
craindre qu’il ne s’agisse que de celles en vogue à l’époque et sans plus. Les
membres de l’ordre du temple étaient bien en contact avec l’orient, parfois
de façon même cordiale avec leurs ennemis musulmans, le sens de l’honneur et
les valeurs de la chevalerie étant alors partagés. Ils lisaient les textes
saints, ils échangeaient sur le plan religieux, ils s’imprégnaient de la
science des symboles et de l’alchimie, et en effet beaucoup de ceux-ci ornent
les édifices religieux d’Europe et du Proche-Orient, édifices templiers ou
non. Certains des symboles qu’ils mettaient à l’honneur sont même extrêmement
universels, comme on le verra ci-dessous : la croix elle-même, et sinon
le pentagone, les références aux étoiles, aux constellations, au zodiaque…
Tous ceux-ci sont étudiés et expliqués dans l’ouvrage « l’évangile selon le monde »
librement téléchargeable en cliquant ici. Une autre représentation, reproduite ci-dessous, ressemble
aussi énormément au carré Sator une fois qu’il ait été décrypté, comme il
l’est pour la première fois dans ce même ouvrage déjà cité, « l’évangile selon le
monde », et librement téléchargeable en cliquant ici. Ci-dessus, un symbole
templier, à comparer au carré sator et à sa recomposition selon le système
codé expliqué dans « l’évangile selon le monde » : le dessin
est en effet très semblable (on retrouve le a et le o, on peut remplacer
l’étoile par un e, et un autre cercle semblable au theta grec par le t)… les
Templiers en avaient-ils connaissance ? Ces images et ces connaissances sont certainement les plus
importantes et les plus profondes : elles sont sans doute les vrais
savoirs des Templiers, ceux qui leur permettront de naviguer sous les
étoiles, peut-être même jusqu’en Amérique par le biais de leurs successeurs
du temps des grandes découvertes d’après certains ; mais ces images et
ces connaissances permettent aussi de relier tout cet univers symbolique avec
des réalités géographiques, et avec la terre, et avec notre monde, d’une
façon générale. Il est ici question des croyances concernant les forces qui
le gouvernent et qui sont de la volonté de Dieu selon les croyants qu’étaient
les Templiers, ou des lois de l’univers selon les autres : voir notamment l’ouvrage librement téléchargeable
ci-dessous. Ou alors les Templiers auraient-ils eu des renseignements sur
la famille authentique de Jésus, sur son père véritable qui semble bien être
en réalité Joseph d’Arimathie, sur la vraie place de saint Jean etc ? Beaucoup
de ces vérités semblent en effet avoir été connues originellement, mais
cachées lorsque les chrétiens devaient vivre dans la clandestinité, puis
enfin largement perdues avec le temps : voir notamment l’ouvrage librement téléchargeable
ci-dessous. Et, en effet, nul besoin
d’imaginer des trésors et des théories incertaines, alors qu’il y a déjà tant
à savoir et qui est méconnu sur le cercle de Jésus, les tout premiers
chrétiens et les mystiques qui les ont suivis : |
En parcourant
l’histoire de Marie-Madeleine et de Jésus, nous croisons certes des croyances
et religions plus anciennes, et qui ont beaucoup à voir avec les grandes lois
universelles et qui proviennent de Dieu selon les croyants. Il y a beaucoup de
ces symboles, de ces signes, de ces croyances, qui sont reliés aux mythes anciens, les héros de l’antiquité inscrits dans
les étoiles et dans les constellations et qui préfiguraient la venue du Christ,
et aux civilisations qui annonçaient cet avènement ; de même en ce qui concerne
le sens et les dates des messages prophétiques ou des apparitions de la vierge Marie, là encore inscrites dans
ce qui semble être un plan bien défini ; des mystères chrétiens tels que le symbole de la croix et la
nécessité que Jésus ait été crucifié ; le message de Jésus et la phrase
« Dieu est amour »… autant de faits qui sont liés, et l’on peut en
saisir la raison. Autant de faits qui permettent de mieux comprendre le message
des textes chrétiens, de la bible, des évangiles, et comment le Christianisme a éclos, dans une sphère où se
mêlaient influences esséniennes, païennes,
ou beaucoup plus anciennes et plus universelles encore, et qu’on soupçonne
rarement. Ces éléments permettent d’établir des liens étonnants et insoupçonnés
entre les lieux des différentes apparitions mariales, l’orientation du monastère de Qumran, ce qui n’avait pas été vu jusque-là, la géométrie de la grande pyramide avec des considérations
inédites, et de nombreux autres symboles tels que le célèbre
« carré sator », célèbre mais qui n’avait pas été compris auparavant :
Ces considérations renvoient à des croyances très anciennes touchant aux
symboles et aux mythes, et notamment celles permettant de brosser
une brève reconstruction
de l’éclosion du Christianisme, avec les influences qui l’ont accompagnée, et même
d’apporter un éclairage nouveau sur le Jésus
historique : le passage de l’œuvre de Flavius Josèphe le concernant, son
nom, sa famille, son entourage… ainsi que, inversement, sur la
thèse d’un Jésus mythique et le rôle de saint Paul, ou sur le
tombeau attribué à Jésus à Talpiot.
À la lecture de ces lignes, difficile de ne
pas y voir quel message universel se dégage, si important de nos
jours. Il semble puiser dans des signes visibles par tous de par le monde, des
mythes et symboles qu’on retrouve dans plusieurs religions et qui les relient
entre elles et avec le Christianisme. Et difficile de ne pas voir
les liens évidents et très nombreux entre tous les courants du Christianisme
entre eux et avec d’autres religions telles que le bouddhisme et l’islam :
ce n’est plus à démontrer pour tous ceux qui sont curieux et
ouverts, mais cela apparaît d’une façon particulièrement claire quand on
s’intéresse aux mythes et symboles les plus anciens et qui se révèlent dans la
religion chrétienne, ainsi qu’on le voit dans « l’évangile selon le monde », déjà cité et
librement téléchargeable ici.
Pour le lire gratuitement cliquer ici.
On peut
même constater que : « les
liens entre les messages de Dieu, perçus par les sages, les prophètes et les
mystiques du monde entier, sont si nombreux et si évidents qu’il y a des ponts
très visibles entre tous les humains : le père Henri Le Saux, notamment, a
été l’un de ces nombreux ponts entre le Christianisme et l’hindouisme. On se
rend compte de la proximité entre certaines notions à travers notamment ces
mots : « c'est dans la mesure même où l'homme pénètre en soi qu'il
pénètre en Dieu et dans la mesure tout autant où il pénètre en Dieu qu'il
parvient à soi. Pour trouver Dieu en réalité, il lui faut descendre jusqu'en
cette profondeur de soi où il n'est plus qu'image de Dieu ; là même où au
jaillissement de soi, il ne se trouve plus que Dieu. » (père Henri Le Saux,
« sagesse
hindoue, mystique chrétienne »), qui entrent en résonnance également avec ceux de nombreux mystiques
chrétiens depuis le moyen-âge. Mais c’est loin d’être tout. Ainsi quand on lit
« heureux vivons-nous, sans haine parmi les
haineux; au milieu des hommes qui haïssent nous demeurons sans haïr »,
l’on pourrait aisément y voir une phrase des évangiles et pourtant il s’agit
d’une phrase de l’un des principaux livres du bouddhisme (« le
dhammapada », 197). Quant à ces mots : « dites : “nous croyons
en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers Abraham
et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à moïse et
à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur seigneur : nous
ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui nous sommes soumis” »,
l’on pourrait les croire issus de la bible, et ils sont extraits du coran
(2,136), l’idée de soumission dans l’islam étant à rapprocher de la racine
sémitique ŠLM, paix, et tout autant donc à celle d’alliance de l’Ancien et du
Nouveau Testament : alliance avec Dieu, entente avec Dieu, fidélité à
Dieu, pour vivre en harmonie avec Dieu, ses créations et tous les hommes, et
dans le respect des textes saints des prophètes. Toute la révélation et l’œuvre
de Mahomet consiste d’ailleurs à propager le message de la bible dans le monde
arabe, établissant ce qui doit donc être un nouveau pont évident entre les
croyances et les régions du monde entier. » (extraits de « l’évangile selon le monde », livre IV et de « l’évangile selon l’olivier », lui aussi
téléchargeable librement en cliquant sur ce lien)
Logiquement, sans qu’il ne soit besoin de faire intervenir
quelque croyance mystérieuse ou hérétique, les relations entre les musulmans et
les Templiers, et plus généralement avec les chrétiens, sont avérées depuis
bien longtemps, et même au temps des croisades qui, on l’a dit, opposaient les
turcs et les européens, et non pas les chrétiens et les musulmans. Car comme
souvent ce sont bien les conflits politiques, économiques, territoriaux, ce
sont eux et eux seuls qui sont à la source de toutes les oppositions, de toutes
les divisions, de toutes les haines savamment entretenues par ceux qui veulent
enflammer les foules pour motiver les combattants.

Islam et Christianisme au XIème siècle, carte issue
de Wikipédia
Et saint François d’Assise rencontrant le sultan Al-Kamil
Les proximités
étaient pourtant encore très fortes, et même à ces moments plus troublés les
Templiers, puis les Franciscains, échangeaient avec les Musulmans, lisaient
leurs textes ; de même inversement en Sicile, à Malte, et bien sûr en Espagne
lors du temps de l’Andalousie, grande période de tolérance et d’échanges entre
toutes les religions du Livre.
On retrouve les mêmes sources, les mêmes messages essentiels
disions-nous ; on retrouve également les mêmes moments importants dans
l’histoire et les mêmes apogées, que ce soit quand on considère l’ensemble des
courants du Christianisme en occident, ou bien les courants de l’islam en
orient. Les échanges, les influences, les liens ont été très forts et très
évidents dès les origines, et les ponts ont été très nombreux et très
importants, même aux moments les plus tendus, notamment sous l’égide de saint François
d’assise, ainsi qu’on s’en rend compte également dans le livre III de « l’évangile selon les
prophètes et les mystiques » ou dans « l’évangile selon l’olivier », lui aussi
téléchargeable librement en cliquant sur ce lien. Les liens
de proximité avec le monde musulman apparaissent encore plus nettement quand on
considère la vie et l’œuvre des prophètes de la bible et des mystiques qui les
ont suivis, parmi lesquels il est difficile de ne pas faire figurer le prophète
de l’islam (voir « l’évangile selon les prophètes et les
mystiques » et « l’évangile selon l’olivier ») : on
retrouve les mêmes sources, on retrouve les mêmes messages principaux, et des
ressemblances évidentes : de nombreux critères fondamentaux identiques qui
apparaissent par exemple au moyen de ce tableau (au moins 17 sur les 22 listés
ci-dessous): on peut
le lire plus commodément là aussi dans « l’évangile selon l’olivier » , lui aussi téléchargeable
librement en cliquant sur ce lien:
Les similitudes
sont telles qu’on peine parfois à distinguer les messages issus d’une religion
ou d’une autre. Voici un nouvel extrait de « l’évangile selon l’olivier », qui les met en parallèle de cette façon souvent très
spectaculaire :
Pour lire la suite, entièrement gratuitement, cliquer ici.
Menu
« être chrétien » :













